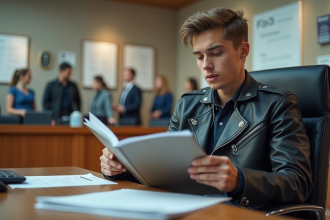En 2023, l’autoroute A35 en Allemagne a accueilli ses premiers essais de recharge dynamique pour véhicules électriques. Cette expérimentation s’appuie sur une technologie par induction intégrée à la chaussée, testée sur un tronçon de 1 km, permettant à des voitures de récupérer de l’énergie sans s’arrêter. Le projet a obtenu un financement public de 7,5 millions d’euros.
Malgré l’intérêt industriel et les annonces de prototypes, aucun modèle homologué pour la conduite quotidienne n’existe à ce jour. Les verrous réglementaires, techniques et économiques freinent le déploiement à grande échelle. Les premiers retours d’expérience restent limités aux phases de démonstration.
Recharger en roulant : mythe ou prochaine révolution de la mobilité ?
On associe spontanément la voiture électrique à sa batterie, et la question de l’autonomie surgit aussitôt. Depuis que le freinage régénératif s’est imposé dans le secteur, l’idée de récupérer de l’énergie en roulant ne relève plus du fantasme. Ce dispositif, désormais courant sur la majorité des véhicules électriques, transforme chaque ralentissement en précieux kilomètres gagnés. Mais ce système trouve ses limites : il donne le meilleur de lui-même en ville, là où les arrêts rythment la circulation.
Le changement de paradigme, c’est la recharge par induction dynamique. Ici, plus de branchement, plus d’arrêt imposé : la recharge s’effectue en mouvement, via des bobines enfouies sous l’asphalte et des récepteurs embarqués. La France, la Suède, l’Italie multiplient les tests. Vinci Autoroutes prépare 1,5 km d’A10, Renault expérimente à Satory avec le Kangoo Z.E., tandis qu’ElectReon avance en Suède. L’ambition ? Délivrer la mobilité électrique de la contrainte des pauses recharge.
Dans cette course, certains misent aussi sur les panneaux solaires intégrés au véhicule. Mais la réalité est têtue : leur rendement chute dès que le soleil se fait discret. Résultat, les recharges rapides conservent leurs adeptes. Entre les 350 kW d’Ionity sur autoroute, le réseau Supercharger de Tesla ou l’expansion de Fastned et TotalEnergies, les bornes filaires tiennent le haut du pavé. La recharge en roulant intrigue, mais la promesse reste à concrétiser. Pour l’heure, la route s’annonce longue avant de croiser ces technologies au quotidien.
Comment fonctionne la recharge par induction sous la route ?
Sous la surface, un réseau de bobines électriques attend le passage des véhicules. Dès qu’une voiture électrique équipée s’engage sur la portion préparée, la magie opère : le champ électromagnétique généré par la chaussée est capté par le récepteur placé sous la voiture et converti en énergie. Ce principe de recharge par induction dynamique autorise un passage de courant sans fil, sans contact, sans stationnement.
Pour fonctionner, tout doit être parfaitement calé : la route, le véhicule, le positionnement. Quand la voiture traverse la zone couverte, le transfert d’énergie s’effectue instantanément, via quelques centimètres d’asphalte. La puissance transmise varie selon la technologie, la position du véhicule et la vitesse. La difficulté ? Maintenir un rendement stable malgré les variations du trafic.
Réaliser ce rêve coûte cher. Installer un kilomètre de route à induction nécessite un investissement de plusieurs millions d’euros, bien loin des coûts d’une borne de recharge rapide (autour de 50 000 €). Pourtant, l’enjeu est de taille : alléger les batteries, proposer une mobilité électrique plus flexible et, peut-être, transformer la recharge en un geste invisible, intégré au flot du trafic.
Projets pilotes et avancées récentes : ce que nous apprennent les tests grandeur nature
Les démonstrations s’accumulent et la recharge dynamique par induction quitte peu à peu le monde des concepts. Plusieurs chantiers pilotes en Europe mettent la technologie à l’épreuve du réel. En France, un tronçon de 1,5 km sur l’A10, près de Saint-Arnoult, attire tous les regards. Vinci Autoroutes, accompagné de Vedecom et de Renault, y teste une version modifiée du Kangoo Z.E. pour mesurer la faisabilité d’une recharge sans arrêt, au rythme du trafic.
Autre terrain d’expérimentation : Paris et Versailles. Ici, le projet INCIT-EV s’appuie sur l’Avere-France, Enedis, l’Université Gustave Eiffel, Colas et la Ville de Paris pour éprouver la recharge dynamique en milieu urbain. L’objectif : vérifier la robustesse du système face aux contraintes, à l’usure et aux usages du quotidien.
Au-delà des frontières françaises, la Suède joue les pionnières sur l’île de Gotland. La société ElectReon y équipe une route pour bus et camions électriques. L’Italie aussi se lance dans l’aventure. Partout, la promesse demeure la même : offrir à la mobilité électrique une alimentation continue, limiter le recours à des batteries surdimensionnées et ouvrir la voie à de nouveaux modes de déplacement.
Voici quelques exemples concrets de projets déjà sur la route :
- Autoroute A10 : 1,5 km de recharge dynamique par induction
- INCIT-EV : tests à Paris et Versailles
- Gotland (Suède) : bus et camions expérimentent la recharge en roulant
Chaque essai grandeur nature affine la compréhension des défis techniques, du rendement énergétique et de l’intégration dans les véhicules. Ces retours d’expérience alimentent l’optimisme, mais rappellent aussi la complexité du passage à une industrialisation massive.
Quels défis restent à relever avant une adoption à grande échelle ?
Derrière le rêve, la réalité s’impose : la recharge dynamique par induction doit franchir une série d’obstacles avant de s’imposer sur nos routes. D’abord, l’ampleur des travaux à engager : déployer des kilomètres de bobines sous l’asphalte implique des budgets considérables, se chiffrant en millions d’euros pour chaque kilomètre. À titre de comparaison, une borne de recharge rapide de 150 kW coûte environ 50 000 €, un écart qui pèse lourd dans le choix des investissements publics et privés.
Pour les véhicules électriques, la diversité des modèles complique la donne. Entre Tesla Model 3, Renault Zoé, Peugeot e-208, Dacia Spring, Fiat 500e, chaque constructeur avance avec ses propres standards. L’adoption d’un système de récepteurs compatible reste marginale, freinant la généralisation de la recharge par induction dans les chaînes de production.
Sur le plan énergétique, la recharge sans fil présente des pertes supérieures à la recharge filaire, surtout à vitesse élevée ou sur de longues distances. Trouver le bon équilibre entre puissance, sécurité et efficacité énergétique relève d’un véritable défi technique.
Le maillage de la recharge publique s’étend à grande vitesse : la France comptait déjà plus de 150 000 points début 2024, avec l’objectif d’atteindre 400 000 bornes d’ici 2027. Les réseaux comme Ionity, Supercharger, Fastned ou TotalEnergies misent sur la rapidité et la fiabilité, tandis que la recharge dynamique doit encore prouver sa valeur face à cet essor des solutions classiques.
La mobilité électrique avance, portée par l’innovation et l’audace des pionniers. Mais la route vers la recharge en roulant, accessible à tous, reste semée de défis à relever. Demain, filera-t-on vers la mer, batterie pleine et mains libres, sans même lever le pied ? Rien n’est encore écrit, mais la course est lancée.